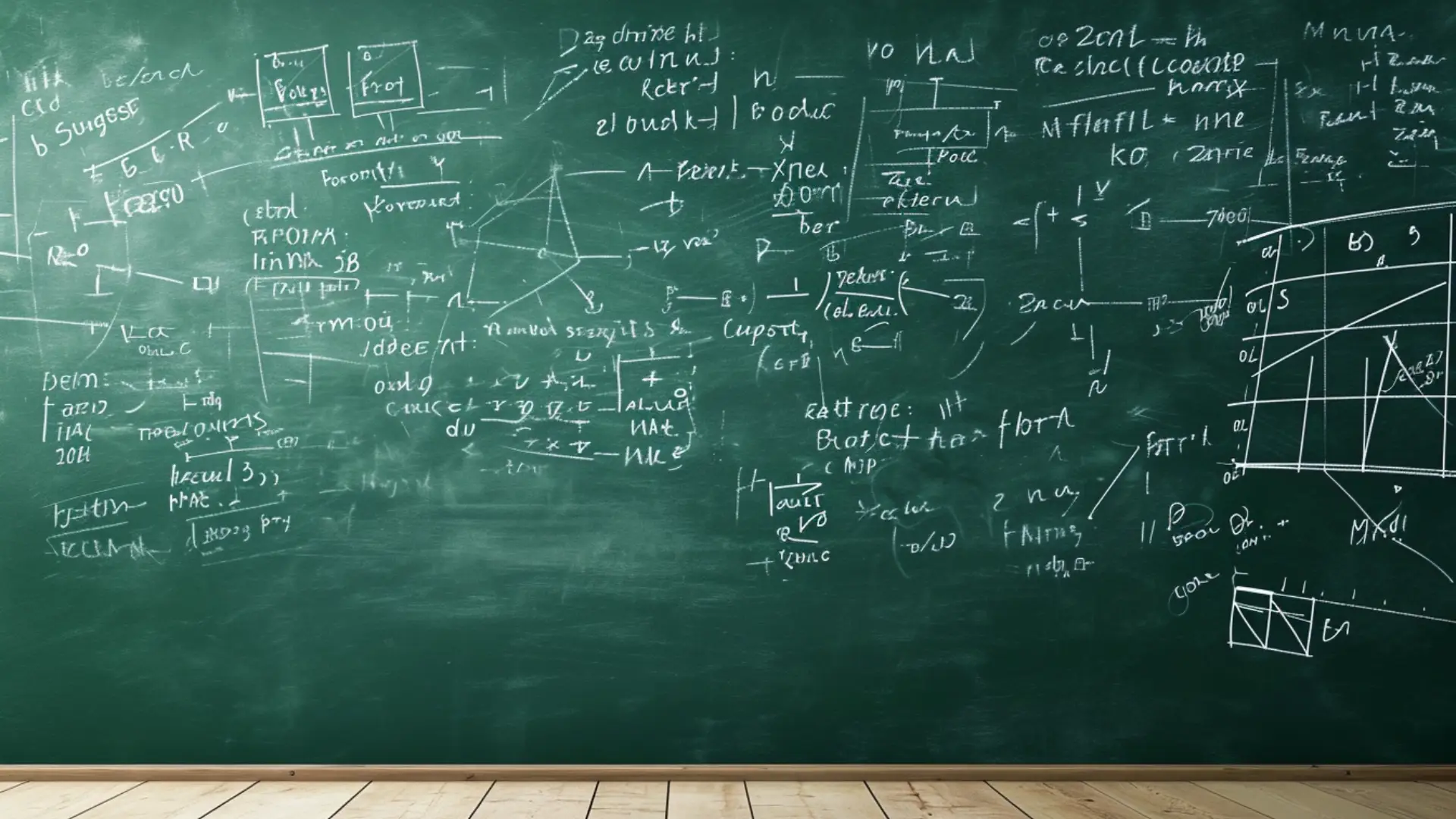
Clarification du TAEG par la CJUE : transparence et protection des emprunteurs
Le 21 mars 2024, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a apporté des clarifications importantes sur le calcul du Taux Annuel Effectif Global (TAEG) pour les crédits à la consommation. Cette décision vise à renforcer la transparence et à offrir une meilleure protection aux emprunteurs en standardisant les éléments à inclure dans le TAEG. Comprendre ces changements est essentiel pour les professionnels du secteur financier, mais également pour les consommateurs qui souhaitent faire des choix éclairés en matière de crédit.
Le TAEG représente le coût total d’un crédit, exprimé en pourcentage annuel. Il permet aux emprunteurs de comparer facilement les différentes offres de crédit en considérant l’ensemble des frais associés. Toutefois, jusqu’à cette clarification, certaines ambiguïtés persistaient quant aux éléments à intégrer dans ce calcul, rendant parfois la comparaison des offres de crédit complexe et trompeuse. La décision de la CJUE vise à lever ces ambiguïtés et à uniformiser les pratiques à travers l’Union européenne. En se penchant sur les éléments inclus et exclus du TAEG, ainsi que sur les différences entre le TAEG et le taux d’usure, cet article explore l’impact de cette clarification sur les emprunteurs et le marché du crédit en général.
Contexte et importance de la clarification du TAEG
Avant la clarification de la CJUE, le calcul du TAEG pouvait varier d’un établissement financier à l’autre, ce qui compliquait la comparaison des offres de crédit. La standardisation des éléments à inclure dans le TAEG est cruciale pour assurer une transparence accrue et une meilleure protection des consommateurs. En comprenant mieux le coût réel de leurs emprunts, les consommateurs peuvent prendre des décisions financières plus avisées et éviter les mauvaises surprises.
La CJUE a spécifié que le TAEG doit inclure tous les coûts associés au crédit. Cela permet de fournir aux consommateurs une vue d’ensemble claire et précise du coût total de leur crédit. Cette décision s’inscrit dans une démarche de protection des consommateurs, qui peuvent ainsi mieux comprendre et comparer les offres de crédit disponibles sur le marché.
Éléments inclus dans le TAEG
Selon la décision de la CJUE, les éléments suivants doivent être inclus dans le calcul du TAEG :
- Les intérêts du prêt : c’est le coût principal de l’emprunt, calculé sur la base du taux nominal.
- Les frais de dossier : ces frais administratifs sont liés à la mise en place du prêt. Ils peuvent varier selon les établissements, mais doivent toujours être inclus dans le TAEG.
- Les frais d’assurance : l’assurance emprunteur, souvent obligatoire, peut représenter une part significative du coût total. Les coûts de cette assurance doivent être inclus dans le TAEG.
- Les frais payés à des intermédiaires : cela inclut les commissions versées à des courtiers ou agents. Si un intermédiaire est impliqué dans l’obtention du crédit, ses frais doivent être inclus dans le calcul du TAEG.
Éléments exclus du TAEG
Certains frais ne doivent pas être inclus dans le calcul du TAEG, car ils ne sont pas directement liés au coût de l’emprunt. Voici les principaux frais exclus :
- Les frais de notaire : ces frais sont généralement associés à l’acquisition de biens immobiliers et ne sont pas directement liés au coût du crédit.
- Les indemnités de remboursement anticipé : si l’emprunteur décide de rembourser son crédit par anticipation, les frais associés à cette opération ne doivent pas être inclus dans le TAEG.
- Les frais liés à un manquement : les pénalités pour retard de paiement ou autres manquements contractuels ne sont pas inclus dans le TAEG, car ils dépendent du comportement de l’emprunteur et ne font pas partie du coût initial du crédit.
Impact de la clarification sur les emprunteurs
Cette clarification du TAEG par la CJUE a un impact significatif sur les emprunteurs. En standardisant les éléments à inclure dans le TAEG, elle facilite la comparaison des offres de crédit. Les emprunteurs peuvent désormais comparer les coûts totaux de différentes offres de crédit de manière plus transparente et plus équitable.
Pour les professionnels du secteur financier, cette décision implique une adaptation des pratiques de calcul du TAEG afin de se conformer aux nouvelles règles. Cette transition pourrait nécessiter des ajustements dans les systèmes de gestion et de communication des offres de crédit. Cependant, à long terme, cela renforcera la confiance des consommateurs dans les institutions financières et pourrait améliorer la concurrence sur le marché du crédit.
Différences entre TAEG et taux d’usure
Il est crucial de différencier le TAEG du taux d’usure, bien que ces deux concepts soient liés au coût des crédits. Le TAEG est un indicateur du coût total du crédit pour l’emprunteur, englobant tous les frais associés à un crédit. En revanche, le taux d’usure est un seuil légal, déterminé par la Banque de France, qui fixe le taux maximal que les prêteurs peuvent appliquer.
- TAEG : Il aide les emprunteurs à comprendre le coût réel de leur crédit. Il inclut les intérêts, les frais de dossier, les frais d’assurance et les commissions des intermédiaires.
- Taux d’usure : il vise à protéger les emprunteurs contre les taux d’intérêt excessifs. Si un prêt dépasse ce taux, il est considéré comme usuraire et le prêteur peut être sanctionné.
La distinction est importante, car elle permet aux emprunteurs de vérifier à la fois le coût total de leur crédit, et de s’assurer que les taux appliqués sont conformes à la législation en vigueur.
Importance pour les emprunteurs
Pour un emprunteur particulier, le TAEG est un outil indispensable pour :
- Connaître le coût total de leur emprunt : le TAEG englobe tous les frais liés au crédit, offrant une image claire du coût réel du prêt.
- Comparer les offres de différents prêteurs : grâce à la standardisation du calcul, le TAEG permet de comparer objectivement les offres, facilitant ainsi le choix de l’offre la plus avantageuse.
- S’assurer que le taux n’est pas usuraire : le TAEG doit être inférieur au taux d’usure fixé par la Banque de France. Si ce n’est pas le cas, le prêt est considéré comme usuraire, et donc illégal.
- Négocier les conditions de leur crédit : en connaissant le poids de chaque élément dans le TAEG, les emprunteurs peuvent négocier plus efficacement les différents aspects de leur prêt pour en réduire le coût global.
Influence sur les mensualités
Bien que le TAEG n’affecte pas directement le montant des mensualités, il indique le coût total du crédit. Le montant des mensualités dépend principalement du montant emprunté, de la durée du prêt et du taux nominal. Toutefois, un TAEG plus élevé signifie un coût total plus important pour le crédit, même si les mensualités elles-mêmes restent inchangées.
Pour les emprunteurs, il est crucial de comprendre cette distinction. Un taux nominal attractif semble avantageux, mais si le TAEG est élevé en raison de frais annexes importants, le coût total du crédit sera plus élevé. C’est pourquoi il est essentiel de tenir compte du TAEG dans l’évaluation et la comparaison des offres de crédit.
La clarification du calcul par la CJUE représente une avancée majeure pour la transparence et la protection des consommateurs dans le secteur du crédit. En standardisant les éléments à inclure dans le TAEG, cette décision facilite la comparaison des offres de crédit et permet aux emprunteurs de mieux évaluer le coût réel de leurs emprunts.
Pour les consommateurs, comprendre le TAEG et ses implications est crucial pour faire des choix financiers éclairés. En offrant une image claire et précise du coût total d’un crédit, le TAEG permet non seulement de comparer les offres de manière objective, mais également de s’assurer que les taux appliqués respectent la législation en vigueur. Cette transparence renforce la confiance des emprunteurs dans les institutions financières et contribue à un marché du crédit plus équitable et compétitif.
Pour les professionnels du secteur, cette décision implique des ajustements nécessaires pour se conformer aux nouvelles règles, mais elle promet également une meilleure relation avec les clients grâce à une plus grande transparence. En fin de compte, la clarification du TAEG par la CJUE est bénéfique pour toutes les parties impliquées, en promouvant des pratiques de crédit plus transparentes et plus justes.
Lire la suite

Naviguer dans le RGPD : implications et meilleures pratiques pour les entreprises locales
Dans le paysage numérique d’aujourd’hui, la protection des données personnelles est devenue une préoccupation centrale pour les consommateurs comme pour les régulateurs. Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), entré en vigueur en mai 2018, a marqué un tournant significatif dans la réglementation de la confidentialité des données au sein de l’Union européenne. Conçu pour renforcer et unifier la protection des données pour tous les individus au sein de l’UE, le RGPD a des implications étendues qui touchent toutes les organisations collectant, traitant ou manipulant des données personnelles des résidents de l’UE, y compris les entreprises locales opérant à des échelles plus modestes.
L’importance du RGPD ne réside pas uniquement dans les obligations qu’il impose, mais également dans les droits qu’il confère aux individus — le droit à la transparence, à l’accès, et à la portabilité des données, pour n’en nommer que quelques-uns. Pour les entreprises, la conformité n’est pas seulement une question légale, mais aussi une question de confiance et de réputation. Dans un monde dans lequel une seule violation de données peut ébranler la confiance des consommateurs et des partenaires commerciaux, la conformité au RGPD est devenue un élément crucial de la stratégie commerciale.
Cependant, naviguer dans les eaux du RGPD peut s’avérer complexe, en particulier pour les petites et moyennes entreprises qui ne disposent pas toujours des ressources juridiques internes. C’est là que cet article intervient. Nous souhaitons démythifier le RGPD pour les entreprises locales, en mettant en lumière les exigences clés et en proposant des stratégies pratiques pour une conformité efficace et continue. Nous explorerons, non seulement, ce que le RGPD exige, mais également comment ces exigences peuvent être transformées en meilleures pratiques commerciales, aidant votre entreprise à protéger, autant les données personnelles de vos clients, que la viabilité et la réputation de votre entreprise dans ce marché numérique en évolution rapide.
I. Comprendre le RGPD
A. Historique et objectifs du RGPD
Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) est le résultat d’années de travail et de négociations au sein de l’Union européenne, visant à remplacer la Directive sur la protection des données de 1995. Cette réforme était nécessaire pour s’adapter à l’ère numérique en rapide évolution dans laquelle nous vivons. Entré en vigueur le 25 mai 2018, le RGPD a été conçu avec plusieurs objectifs clés en tête :
- Harmonisation des lois sur la protection des données : avant le RGPD, chaque État membre de l’UE avait sa propre loi sur la protection des données, créant un patchwork de réglementations. Le RGPD a standardisé la protection des données à travers l’UE, rendant les opérations transfrontalières plus prévisibles pour les entreprises.
- Renforcement des droits des individus : le RGPD a accru les droits des personnes concernées, leur donnant plus de contrôle sur leurs données personnelles. Cela inclut des droits tels que l’accès aux données, leur rectification, leur effacement (le “droit à l’oubli”), et la portabilité des données.
- Responsabilisation des entreprises : le RGPD impose aux entreprises de mettre en œuvre des mesures appropriées pour protéger les données personnelles et de démontrer leur conformité. Cela inclut la tenue de registres des activités de traitement des données, la réalisation d’analyses d’impact relatives à la protection des données pour les traitements à haut risque, et la notification des violations de données aux autorités de contrôle et aux individus concernés.
B. Principes fondamentaux du RGPD
Le RGPD repose sur sept principes fondamentaux qui doivent guider le traitement des données personnelles :
- Licéité, équité et transparence : les données doivent être traitées légalement, équitablement et de manière transparente.
- Limitation des finalités : les données doivent être collectées à des fins spécifiques, explicites et légitimes.
- Minimisation des données : seules les données nécessaires à ces fins doivent être collectées et traitées.
- Exactitude : les données doivent être exactes et, de préférence, à jour.
- Limitation de la conservation : les données doivent être conservées uniquement aussi longtemps que nécessaire pour les finalités pour lesquelles elles sont traitées.
- Intégrité et confidentialité : les données doivent être traitées de manière à assurer une sécurité adéquate, y compris la protection contre le traitement non autorisé ou illicite et contre la perte, la destruction ou les dommages accidentels.
- Responsabilité : le responsable du traitement est responsable de la conformité au RGPD et doit être en mesure de la démontrer.
C. À qui s’applique le RGPD : entreprises et données concernées
Le RGPD s’applique à toute organisation, quelle que soit sa taille, qui traite des données personnelles liées à :
- Des activités offertes dans l’UE : Toute entreprise qui offre des biens ou des services (même gratuitement) aux résidents de l’UE.
- Le comportement de personnes dans l’UE : Cela s’applique si une entreprise surveille le comportement de personnes se trouvant dans l’UE (par exemple, le suivi en ligne des consommateurs).
Il est également crucial de comprendre que le RGPD s’applique, par ailleurs, aux organisations basées dans l’UE, et à celles basées en dehors si elles traitent des données concernant des individus dans l’UE. En termes de données, le RGPD couvre une large gamme d’informations personnelles. Cela inclut les noms, les adresses, les informations de santé, les données de localisation, les identifiants en ligne, les éléments biométriques, les données raciales ou ethniques, les opinions politiques, et les croyances religieuses ou philosophiques, entre autres.
II. Implications du RGPD pour les entreprises locales
A. Exigences de conformité : un aperçu
La conformité au RGPD n’est pas une tâche ponctuelle, mais un processus continu qui nécessite une vigilance constante de la part des entreprises. Voici un aperçu des principales exigences que les entreprises réunionnaises doivent considérer :
- Analyse d’impact relative à la protection des données (AIPD) : Pour les types de traitement susceptibles d’entraîner un risque élevé pour les droits et libertés des individus, les entreprises sont tenues de réaliser une AIPD. Cela implique d’identifier, d’évaluer et de documenter ces risques et de déterminer les mesures appropriées pour les atténuer.
- Consentement et bases légales pour le traitement : le consentement doit être donné librement, être spécifique, éclairé et sans ambiguïté. Si le consentement n’est pas applicable, les entreprises doivent s’appuyer sur d’autres bases légales pour le traitement, telles que l’exécution d’un contrat, les obligations légales, les intérêts légitimes, etc.
- Protection des données dès la conception et par défaut : les entreprises doivent intégrer des mesures de protection des données dans leurs produits et services dès la phase de conception et garantir que, par défaut, seules les données personnelles nécessaires à chaque objectif spécifique du traitement sont traitées.
- Délégué à la protection des données (DPD) : Certaines entreprises sont tenues de nommer un DPD, en particulier celles dont les activités principales impliquent un suivi régulier et systématique à grande échelle des individus ou le traitement à grande échelle de catégories particulières de données.
- Registres de traitement des données : les entreprises doivent tenir des registres détaillés de leurs activités de traitement de données, y compris les finalités du traitement, les catégories de données traitées et les transferts de données vers des pays tiers.
B. Les droits des individus sous le RGPD
Le RGPD a considérablement renforcé les droits des individus concernant leurs données personnelles. Les entreprises doivent être conscientes et respecter ces droits, notamment :
- Droit d’accès : les individus ont le droit de savoir si leurs données sont traitées et, si c’est le cas, d’accéder à ces données.
- Droit de rectification : les individus peuvent exiger que des données inexactes soient corrigées.
- Droit à l’effacement (« droit à l’oubli ») : Dans certains cas, les individus peuvent demander que leurs données soient effacées.
- Droit à la limitation du traitement : les individus peuvent demander la suspension du traitement de leurs données dans certaines circonstances.
- Droit à la portabilité des données : les individus peuvent demander leurs données dans un format structuré et couramment utilisé ou demander leur transfert direct à un autre responsable du traitement.
- Droit d’opposition : les individus peuvent s’opposer au traitement de leurs données pour des raisons liées à leur situation particulière.
C. Conséquences de la non-conformité : sanctions et amendes
Le non-respect du RGPD peut entraîner des conséquences sévères. Les autorités de contrôle ont le pouvoir d’imposer des amendes administratives qui peuvent atteindre jusqu’à 20 millions d’euros ou 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu. Ces sanctions peuvent être imposées pour des infractions telles que :
- Violation des principes premiers pour le traitement, y compris les conditions de consentement.
- Violation des droits des individus.
- Transferts de données personnelles vers des pays tiers ou des organisations internationales en violation du RGPD.
Outre les amendes, les entreprises peuvent également faire face à des dommages réputationnels, à une perte de confiance des clients, et à des coûts associés à la rectification des problèmes de conformité. Par conséquent, la conformité au RGPD doit être une priorité absolue pour les entreprises locales.
III. Meilleures pratiques pour la conformité au RGPD
A. Évaluation et gestion des données
La gestion efficace des données est au cœur de la conformité au RGPD. Les entreprises doivent à la fois, comprendre les types de données qu’elles détiennent, mais aussi comment elles sont utilisées, stockées, sécurisées et éliminées. Voici quelques étapes clés pour une gestion des données conforme au RGPD :
1. Cartographie des données
La cartographie des données est le processus de création d’un inventaire des données personnelles que votre entreprise traite. Cela implique de comprendre quelles données vous avez, d’où elles viennent, comment elles sont traitées, où elles sont stockées, avec qui elles sont partagées, et comment elles sont éliminées ou modifiées. Voici comment procéder :
- Identifier les données personnelles : commencez par identifier toutes les données personnelles que votre entreprise détient. Cela inclut les informations des clients, des employés, des partenaires commerciaux, etc. N’oubliez pas que les données personnelles sous le RGPD couvrent une large gamme d’informations.
- Évaluer le flux de données : documentez comment les données entrent dans votre entreprise, où elles sont stockées, comment elles sont utilisées, qui y a accès, et où elles vont si elles quittent votre entreprise. Cela peut impliquer de parler à différents départements et de comprendre leurs processus.
- Créer un registre de traitement des données : sur la base de ces informations, créez un registre détaillé de toutes les activités de traitement des données personnelles. Ce registre doit inclure les catégories de données personnelles, les finalités du traitement, les catégories de destinataires des données personnelles, etc.
La cartographie des données n’est pas seulement une exigence réglementaire ; elle est également utile pour comprendre et améliorer vos processus commerciaux.
2. Analyse des risques
L’analyse des risques, souvent réalisée dans le cadre d’une Analyse d’Impact relative à la Protection des Données (AIPD), est un processus essentiel pour identifier et minimiser les risques liés au traitement des données personnelles. Voici les étapes clés :
- Identifier les risques : sur la base de votre cartographie des données, identifiez les risques pour les droits et libertés des individus. Cela peut inclure des choses comme les violations de données, les accès non autorisés, les pertes de données, etc.
- Évaluer les risques : Évaluez la probabilité et la gravité de chaque risque identifié. Cela implique de considérer autant l’impact potentiel sur les individus que la probabilité que le risque se matérialise.
- Atténuer les risques : identifiez les mesures que vous pouvez prendre pour minimiser ces risques. Cela peut inclure des mesures techniques comme le chiffrement et la “pseudonymisation”, des contrôles d’accès, des sauvegardes régulières, et des mesures organisationnelles comme la formation des employés et la mise en place de politiques et procédures.
- Documenter le processus : gardez des registres détaillés de votre analyse des risques, y compris les risques identifiés, votre évaluation, et les mesures d’atténuation que vous avez mises en place. Cela démontrera votre conformité en cas de contrôle.
L’analyse des risques doit être un processus continu, avec des réévaluations régulières en réponse aux nouvelles menaces, aux incidents de sécurité, ou aux changements dans votre entreprise.
B. Politiques et procédures
Pour assurer la conformité au RGPD, les entreprises doivent mettre en place des politiques robustes et des procédures claires qui régissent la manière dont elles encadrent les données personnelles. Ces politiques et procédures doivent être documentées, facilement accessibles et régulièrement mises à jour. Voici deux domaines clés sur lesquels se concentrer :
1. Politiques de confidentialité et procédures de consentement
Politiques de confidentialité : votre entreprise doit avoir une politique de confidentialité claire et compréhensible qui explique comment vous collectez, utilisez, partagez, et protégez les données personnelles. Cette politique doit facilement être accessible, par exemple, via un lien sur votre site web. Elle doit inclure des informations telles que les types de données que vous collectez, les finalités du traitement, les droits des individus concernant leurs données.
Les coordonnées de votre délégué à la protection des données ou du point de contact pour les questions de confidentialité.
Procédures de consentement : si vous vous fiez au consentement pour traiter les données personnelles, vous devez vous assurer que ce consentement est conforme au RGPD. Cela signifie qu’il doit librement être donné, spécifique, informé et univoque. Vous devez fournir un moyen clair et simple pour les individus de donner ou de retirer leur consentement, et vous devez garder un registre des consentements donnés. Si vous collectez des données sur des enfants, vous devez prendre des mesures supplémentaires pour vérifier l’âge et obtenir le consentement des parents ou des tuteurs, le cas échéant.
2. Formation des employés et sensibilisation
Programmes de formation : tous vos employés doivent comprendre les principes du RGPD et leurs responsabilités en matière de protection des données. Vous devriez avoir un programme de formation régulier qui couvre des sujets tels que la reconnaissance et la prévention des violations de données, la manière de répondre aux demandes des individus concernant leurs données, et les procédures à suivre en cas de violation de données. Cette formation doit être obligatoire pour les nouveaux employés et doit être répétée régulièrement pour tous les employés.
Sensibilisation : En plus de la formation formelle, vous devriez avoir des programmes continus pour sensibiliser vos employés à l’importance de la protection des données. Cela pourrait inclure des communications régulières, des affiches ou des rappels dans les espaces de travail, et des événements ou des présentations sur des sujets liés à la protection des données. Vous devriez également encourager une culture d’entreprise qui valorise la confidentialité et la sécurité des données, où les employés se sentent capables de signaler les problèmes et de poser des questions sans crainte de répercussions.
C. Planification de la réponse aux incidents
Même avec les meilleures protections en place, les incidents peuvent survenir. Le RGPD exige des entreprises qu’elles soient préparées à réagir rapidement et efficacement en cas de violation de données ou de demandes des titulaires de données. Voici comment votre entreprise peut se préparer :
1. Notification de violation de données
- Procédures de détection et d’évaluation : Mettez en place des systèmes pour détecter les violations de données dès qu’elles se produisent. Cela peut inclure des systèmes de surveillance de la sécurité, des audits réguliers et des évaluations de sécurité. Lorsqu’une violation est détectée, évaluez rapidement la nature et l’étendue de la violation, les données affectées, et les risques pour les droits et libertés des individus.
- Plan de réponse aux violations : ayez un plan en place détaillant comment votre entreprise répondra à une violation de données. Cela devrait inclure des étapes pour contenir la violation, évaluer les risques, notifier les autorités de contrôle, et communiquer avec les individus affectés, si nécessaire. Ce plan doit également identifier les membres clés de l’équipe de réponse aux incidents, leurs rôles et responsabilités.
- Notification aux autorités : si la violation est susceptible d’entraîner un risque pour les droits et libertés des individus, vous devez en informer l’autorité de contrôle compétente dans les 72 heures après en avoir pris connaissance. Préparez les modèles de notification et les procédures à l’avance pour vous assurer que vous pouvez respecter ce délai.
- Communication avec les individus affectés : si la violation est susceptible d’entraîner un risque élevé pour les droits et libertés des individus, vous devez également informer ces individus sans retard indu. Votre communication doit inclure une description claire de la violation, ses conséquences possibles et les mesures prises pour y remédier.
2. Gestion des demandes des titulaires de données
- Procédures de réponse : les individus ont divers droits sous le RGPD, et ils peuvent exercer ces droits en soumettant des demandes à votre entreprise. Vous devez avoir des procédures en place pour répondre à ces demandes, y compris la vérification de l’identité de la personne, la compréhension de la nature de la demande et la fourniture d’une réponse dans les délais prescrits (généralement dans le mois suivant la réception de la demande).
- Formation et ressources : assurez-vous que vos employés sont formés et capables de gérer ces demandes. Cela inclut la compréhension des droits des individus sous le RGPD, la manière de traiter les demandes, et où obtenir de l’aide ou des ressources supplémentaires au sein de votre entreprise.
- Documentation : Gardez des registres détaillés de toutes les demandes des titulaires de données et de vos réponses. Cela inclut la date de réception de la demande, la nature de la demande, les étapes prises pour y répondre, et toute communication avec l’individu.
IV. L’avenir du RGPD et du droit de la protection des données
Le paysage de la protection des données est dynamique, influencé par les avancées technologiques, les changements de comportement des consommateurs et les évolutions législatives. Les entreprises doivent rester informées et prêtes à s’adapter aux changements futurs.
A. Évolutions législatives récentes et attendues
- Modifications et précisions du RGPD : Depuis son entrée en vigueur, le RGPD a été sujet à diverses interprétations par les tribunaux de l’UE et les autorités de protection des données. Ces décisions peuvent influencer la manière dont les entreprises doivent se conformer au règlement.
- Nouvelles législations et normes internationales : au-delà du RGPD, d’autres juridictions élaborent leurs propres lois sur la protection des données, comme le California Consumer Privacy Act (CCPA) aux États-Unis. Les entreprises opérant à l’international doivent être conscientes de ces lois et de la manière dont elles interagissent avec le RGPD. De plus, des normes internationales, telles que celles développées par l’Organisation internationale de normalisation (ISO), peuvent également influencer les meilleures pratiques en matière de protection des données.
- Évolution de la jurisprudence : les décisions des tribunaux peuvent avoir un impact significatif sur l’interprétation et l’application du RGPD et d’autres lois sur la protection des données. Les entreprises doivent suivre ces décisions et être prêtes à ajuster leurs pratiques en conséquence.
B. L’importance de la veille réglementaire
- Suivi proactif des changements : les entreprises doivent mettre en place des systèmes pour suivre activement les évolutions législatives, réglementaires et jurisprudentielles. Cela peut impliquer l’abonnement à des bulletins d’information spécialisés, la collaboration avec des associations professionnelles ou la consultation régulière avec des experts juridiques.
- Analyse et adaptation : il ne suffit pas de simplement être informé des changements ; les entreprises doivent également analyser comment ces changements affectent leurs opérations et prendre des mesures pour s’adapter. Cela peut nécessiter la mise à jour des politiques et procédures, la formation des employés ou des changements dans les systèmes techniques.
- Engagement et influence : les entreprises peuvent également envisager de s’engager plus activement dans le processus législatif, par exemple, en répondant aux consultations publiques sur les projets de législation ou en participant à des groupes de travail sectoriels. Cela peut aider les entreprises à anticiper les changements, à préparer leurs réponses, et à influencer le développement de réglementations pragmatiques et réalisables.
Conclusion
Dans le climat commercial actuel, naviguer avec compétence dans les eaux du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) est non seulement prudent, mais essentiel. Cet article a souligné plusieurs domaines cruciaux, notamment la compréhension des principes du RGPD, les implications directes pour les entreprises locales, les meilleures pratiques pour assurer la conformité, et l’importance de rester informé sur les évolutions futures du droit de la protection des données.
Pour conclure, la conformité au RGPD va bien au-delà du simple évitement des sanctions sévères associées à la non-conformité. En respectant ces réglementations, les entreprises locales renforcent la confiance avec leurs clients, démontrant un engagement ferme pour la sécurité et la confidentialité des données. Cette confiance est inestimable, et elle peut significativement améliorer la réputation de l’entreprise, sa relation avec les clients et, par extension, sa viabilité et sa réussite sur le marché.
Cependant, le RGPD est notoirement complexe. Sa nature évolutive signifie que la conformité n’est pas un objectif statique, mais un processus dynamique nécessitant une vigilance constante. Par conséquent, il est fortement recommandé aux entreprises de chercher l’expertise de professionnels juridiques spécialisés dans le domaine de la protection des données. Ces experts peuvent fournir des conseils personnalisés adaptés aux besoins spécifiques de votre entreprise, aidant à naviguer dans les nuances du RGPD et à mettre en place des stratégies robustes pour une conformité durable.
En fin de compte, voire le RGPD, non pas comme un fardeau, mais comme une opportunité, peut inspirer une culture d’excellence et d’intégrité dans la gestion des données. Cela ne protège pas seulement l’entreprise contre les risques juridiques et financiers, mais cela positionne également l’organisation comme un leader responsable et digne de confiance dans son domaine.
Vous vous sentez dépassé par les complexités du RGPD ? Vous n’êtes pas seul. La conformité au RGPD est un voyage complexe, mais vous n’avez pas à le parcourir seul. Notre cabinet est spécialisé dans le droit de la protection des données. Nous sommes ainsi dédiés à aider les entreprises comme la vôtre à naviguer avec confiance dans ces eaux souvent troubles. Contactez-nous dès aujourd’hui pour une consultation.
Lire la suite
Loi ASAP et pérennisation du soutien des entreprises en difficulté
Loi ASAP : pérennisation des mesures pour les entreprises en difficulté face au Covid-19
La loi du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique, ou Loi ASAP, comporte des dispositions de soutien aux entreprises en difficulté. Ces dernières sont accompagnées face à l’urgence sanitaire. Zoom sur la loi ASAP et sa pérennisation des mesures pour les entreprises en difficulté face au Covid-19
Loi ASAP : en complément des ordonnances de soutien aux entreprises en difficulté
Depuis le début de la crise sanitaire du Covid-19, le Gouvernement a pris plusieurs ordonnances destinées à soutenir les entreprises en difficulté. La loi du 23 mars 2020 a ainsi instauré l’état d’urgence sanitaire.
La loi ASAP du 7 décembre 2020 accélère et simplifie l’action publique au bénéfice des entreprises qui en ont le plus besoin. L’objectif : compléter les anciennes actions menées. Les entreprises qui bénéficient d’une procédure de redressement judiciaire peuvent par exemple prendre part à la passation de marchés publics.
Avec cette loi, les entreprises agricoles et exploitations du même secteur continuent de bénéficier des mesures prévues dans l’ordonnance du 20 mai 2020. Ces mesures sont ainsi prolongées jusqu’au 31 décembre 2021, en ce qu’elles concernent notamment la procédure de conciliation et toute mesure de sauvegarde de justice. Le prolongement de ces mesures répond à l’impératif de continuité de l’économie et à la réalité d’une hausse des procédures collectives dans les prochains mois.
Loi ASAP : prolongation des mesures jusqu’au 31 décembre 2021
Les mesures prolongées jusqu’au 31 décembre 2021 sont :
- renforcement du rôle alloué au commissaire aux comptes dans une procédure d’alerte
- suppression des seuils permettant d’ouvrir une procédure de sauvegarde accélérée
- raccourcissement de 30 à 15 jours du délai offert au mandataire judiciaire (ou à l’administrateur) pour consulter les créanciers lors de l’ouverture d’un plan de redressement ou de sauvegarde
- aide pour les entreprises qui ont des difficultés à accéder au crédit classique pendant cette période
- aménagement des seuils pour le rétablissement personnel de l’entreprise et la procédure de liquidation judiciaire simplifiée
- Enfin, possibilité de proroger la procédure de conciliation sur demande du conciliateur. Cependant, la procédure ne peut aller au-delà de 10 mois. De plus, elle doit avoir été ouverte après le 24 août 2020.
Les mesures qui prennent fin avec la loi ASAP
Si certaines mesures se pérennisent jusqu’au 31 décembre 2021 pour soutenir les entreprises en difficulté, d’autres prennent fin.
- l’administrateur judiciaire ou le dirigeant ne peut plus proposer directement au tribunal un projet de reprise. Cette disposition, qui était dérogatoire, avait été prévue le 20 mai 2020. Elle permettait alors de passer outre l’examen obligatoire et préalable par le ministère public, ce qui accélérait alors la procédure
- le délai de convocation des créanciers concernés par un transfert judiciaire à la reprise de l’entreprise est désormais de 15 jours. La mesure dérogatoire prévue par l’ancienne ordonnance prévoyait de porter ce délai à 8 jours. Ce dispositif permettait pourtant de réduire le risque de volatilité des offres. Il arrêtait plus rapidement le plan de cession de l’entreprise.
Le fait de ne pas prolonger ces règles dérogatoires pose question en pratique. Aujourd’hui, le droit des entreprises en difficulté tend à s’adapter davantage au regard des récents événements. Face au contexte économique de la crise sanitaire, le Gouvernement réfléchit à l’instauration d’une procédure exceptionnelle.
Les avocats du cabinet Ake Avocats accompagnent les entreprises en difficulté et vous aident à y voir plus clair sur les possibilités qui s’offrent à vous.
Lire la suite
Qu’est-ce que le régime d’équivalence au travail ?
Réglementation sur la durée du travail : zoom sur le régime d’équivalence applicable
Une durée de travail supérieure à la durée légale est instituée dans certaines professions comportant des périodes d’inaction. On parle alors de régime d’équivalence. Sa mise en place a des conséquences sur la durée hebdomadaire de travail et la rémunération du salarié. Le cabinet AKE Avocats vous éclaire sur cette notion.
Conciliation du régime d’équivalence avec la réglementation sur la durée du travail
La durée du travail équivaut au temps de présence de l’employé au sein de l’entreprise. Certaines catégories d’activités ont des périodes plus ou moins intenses tandis que d’autres comportent des temps d’inaction. Pour pallier cette inégalité, le régime d’équivalence a été mis en place. Au lieu de prendre en compte les heures de présence au sein de l’entreprise, ce système favorise la durée de présence supérieure. Il s’agit des périodes pendant lesquelles le salarié est disponible pour son employeur.
Par exemple, un salarié peut être soumis à une équivalence de 38 heures pour 35 heures de travail. Il est censé être à disposition de son employeur 38 heures par semaine, mais ne travailler que 35 heures.
La Cour de cassation s’est récemment penché sur la question suivante : comment concilier le régime d’équivalence avec les réglementations françaises et européennes ?
Le système d’équivalence au service du décompte des périodes d’inaction
Le système d’équivalence prend en compte les périodes de repos, de coupures et d’inaction au sein de l’entreprise. L’objectif est de réaliser un calcul efficient du travail du personnel.
Seules les heures effectuées au-delà de la durée considérée comme équivalente sont considérée comme des heures supplémentaires. Un taux d’amplitude doit être calculé lorsqu’on déterminer les modalités de travail.
Prenons l’exemple d’un salarié soumis à une équivalence de 38 heures de présence rémunérées sur la base de 35 heures. Les heures accomplies au-delà de la 38ème heure et jusqu’à la 46ème heure par semaine donneront lieu à une majoration de salaire de 25%. Les heures accomplies au-delà de la 46ème heure par semaine donneront lieu à une majoration de salaire de 50%.
La Cour de cassation estime que les règles nationales en matière de temps du travail ne font pas obstacle à la directive européenne de 2003. L’important est de respecter les plafonds communautaires en vigueur. Néanmoins, les juges rappellent dans cet arrêt que les règles européennes imposent une durée de 48 heures au maximum chaque semaine. Le fait d’avoir recours au régime d’équivalence ne peut donc pas porter la durée de travail hebdomadaire à plus de 48 heures, sous peine de contrevenir aux dispositions européennes.
Vous vous interrogez sur le régime d’équivalence et sur le mode de calcul de vos heures de travail dans l’entreprise ? Les experts du cabinet AKE Avocats à La Réunion sont disponibles pour vous conseiller.
Lire la suite
Sort du changement d’horaires touchant un élément de rémunération
Modification d’horaires et impact sur la rémunération du salarié
Dans un arrêt récent du 14 novembre 2018, la Cour de cassation a décidé de sanctionner l’employeur ayant décidé, sans obtenir au préalable l’accord de ses salariés, de modifier leurs horaires de nuit en des horaires de jour, leur faisant ainsi perdre le bénéfice des primes. Cette modification d’horaires, dès lors qu’elle impacte la rémunération des employés, doit être prise avec l’accord de ses derniers. Zoom sur ce principe.
Le principe : la modification libre des horaires de travail par l’employeur
L’arrêt de Chambre sociale du 14 novembre 2018 ne revient pas sur le principe, à savoir qu’une modification d’horaires de travail des salariés est du ressort du pouvoir directionnel de l’employeur. De la sorte, cette modification ne nécessite pas en principe l’accord préalable du salarié. Cela est différent lorsque l’employeur décide d’une modification de la durée de travail des salariés. En effet, dans ce cas, un tel changement induit une modification du contrat de travail, ce qui nécessite alors l’accord préalable du salarié. Deux éléments se distinguent alors :
- la modification des conditions de travail des salariés. Il s’agit pour l’employeur de faire exécuter le même contrat de travail dans des conditions différentes (changement d’horaires notamment). Cela ne nécessite pas l’accord préalable du salarié. Si ce dernier oppose un refus, il commet une faute que l’employeur peut sanctionner, notamment par un licenciement.
- la modification d’un élément essentiel du contrat de travail. Dans ce cas, un tel changement nécessite l’accord préalable de l’employé. Ce dernier peut opposer un refus sans que cela ne soit constitutif d’une faute. Si l’employeur utilise ce refus pour licencier le salarié, le licenciement sera sans cause réelle et sérieuse.
L’exception : la modification restreinte des horaires impactant la rémunération des salariés
Dans l’arrêt paru le 14 novembre 2018, un employeur avait modifié les horaires de ses salariés, les faisant passer d’horaires du soir et de nuit en horaires de jour. Or, ce changement était accompagné de la perte du bénéfice des primes, sans même que les salariés aient donné leur accord au préalable. Ces derniers ont saisi les Prud’hommes pour obtenir une compensation à leurs dommages. En l’espèce, le contrat de travail prévoyait des horaires tournants, comprenant aussi des horaires de jour, fixés selon les nécessités de la production. Les juges de la Cour de cassation considèrent, contrairement à la Cour d’appel, qu’une clause d’un contrat de travail ne permet pas à un employeur de modifier de manière discrétionnaire les éléments essentiels de ce contrat de travail. Les juges ne prennent donc pas en compte une clause contractuelle permettant à l’employeur de changer les horaires unilatéralement et sans l’accord des employés. Or, le changement d’horaires, puisqu’il induisait une perte des primes, était considéré comme un élément essentiel du contrat de travail nécessitant l’accord préalable des salariés. Vous êtes en litige avec votre employeur ou bien vous désirez connaître vos droits en matière de droit du travail ? N’hésitez pas à contacter notre équipe d’avocats spécialisés qui vous répondront rapidement.
![]()

Focus sur la déjudiciarisation en droit du travail
La déjudiciarisation en droit du travail
Est appelée déjudiciarisation le fait de ne pas avoir systématiquement recours au judiciaire en privilégiant d’autres voies, comme le traitement social ou la médiation. Appliquée au droit du travail, cette baisse des contentieux fait grincer quelques dents. Est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle ? En la matière, il n’existe aucune réponse unique. Ayant débuté avec la recrudescence des ruptures conventionnelles homologuées nées sous le signe du sacrosaint consensus, la déjudiciarisation revêt aujourd’hui des visages divers en droit du travail. Zoom sur ce phénomène qui ne fait pas que des adeptes.
Une déjudiciarisation à l’origine d’une baisse de contentieux sociaux
La loi du 25 juin 2008 est venue reprendre cette idée de déjudiciarisation en multipliant les précautions et les garanties pour les parties. L’objectif affiché était alors d’éviter autant que possible tout contentieux. Les délais de réflexion et de rétractation ont ainsi été rallongés. Cette loi a permis de faire baisser de 40 000 le nombre de contentieux prud’homaux en l’espace de 5 ans (plus précisément entre 2009 et 2014).
Avec l’arrêt rendu le 23 mai 2013, la Chambre sociale de la Cour de cassation a sécurisé cette déjudiciarisation en venant préciser que la validité de toute convention de rupture conclue entre les parties n’est pas remise en cause par l’existence d’un différend entre les parties au contrat de travail. Cet arrêt rendu, l’ère a véritablement été celle d’un renouveau, celui du désengorgement des tribunaux prud’homaux, avec un record en 2017 de 432 000 homologations délivrées.
Le barème des dommages-intérêts issus de la déjudiciarisation
Le barème des dommages-intérêts prévus dans l’hypothèse d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse n’est pas du goût de tout le monde. Cette mesure majeure est née des ordonnances du 22 septembre 2017 destinées à remodeler le droit du travail en faveur d’une déjudiciarisation. Le plafond a été établi en fonction de l’ancienneté du salarié : 1 mois de salaire brut pour une ancienneté inférieure à 1 an et 20 mois de salaires bruts maximum pour une ancienneté supérieure à 30 ans. Le plancher est fixé à 3 mois minimum pour une ancienneté supérieure à 2 ans sauf pour une entreprise ayant une trésorerie fragile ou comptant moins de 11 salariés.
Les précautions prises pour encadrer la déjudiciarisation en droit du travail
Mais que cache réellement cette déjudiciarisation dans le monde du travail ? Nombreux sont ceux à estimer que le consensus entre salarié et employeur cache souvent une démission ou un licenciement abusif. N’en déplaise à ses détracteurs, la déjuridictionnalisation a atteint son objectif, également en matière de protection du salarié. L’administration contrôle désormais la procédure, ce qui a fait que le contentieux devant le Tribunal de Grande instance est désormais de 8 % en comparaison avec les 21 % d’il y a quelques années.
Depuis l’ordonnance du 22 septembre 2017, la rupture conventionnelle collective se pare de trois consentements successifs, dans un objectif de protection du salarié. Cette rupture conventionnelle revisitée est alors une synthèse entre les nombreuses évolutions ayant entouré la déjudiciarisation depuis son introduction en droit du travail.
Désormais, les trois consentements successifs sont les suivants :
- un premier consensus avec les syndicats
- un second consensus avec la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte), cette dernière vérifiant notamment que la rupture n’a pas pour origine une éventuelle discrimination
- l’accord éclairé du salarié.
![]()

Nullité de la transaction de rupture après une remise en main propre du licenciement
Nullité de la transaction après la remise en main propre de la lettre de licenciement
En droit du travail, on appelle transaction le contrat par lequel salarié et employeur mettent un terme, par concessions mutuelles, à toute contestation antérieure ou à naître, en lien avec la rupture du contrat de travail. Elle est encadrée par l’ article 2044 du Code civil.
Dans un arrêt de Cour de cassation en date du 10 octobre 2018, la Haute juridiction a estimé qu’une transaction ayant lieu après la rupture du contrat de travail n’est valable que si le licenciement a été notifié par voie de courrier recommandé avec avis de réception.
Déroulement des faits
Toute transaction présuppose que le contrat de travail ait été rompu au préalable puisque son objet est précisément de mettre un terme définitif à toute possibilité de contestation liée à la rupture du contrat. Par son biais, les deux parties s’entendent pour ne pas remettre en cause de quelque manière que ce soit la décision prise ni aucune disposition contractuelle.
En l’espèce, un salarié se fait licencier par son employeur et signe le reçu de remise en main propre de la lettre de licenciement. Deux mois après le licenciement du salarié, l’employeur décide de conclure avec ce dernier un protocole transactionnel. Le salarié signe ce protocole puis en conteste la validité en saisissant les Prud’hommes.
La Cour d’appel saisie de cette affaire (en l’occurrence la Cour d’appel de Basse-Terre) considère que la transaction est valable puisqu’elle a été conclue à la suite de la notification du licenciement au salarié. Elle déboute le requérant de sa demande.
Le protocole transactionnel : un acte soumis à un strict formalisme
Le salarié forme un pourvoi en cassation. Au visa de l’ article L. 1231-4 du Code du travail et L. 1232-6 de ce même Code, la Chambre sociale de la Cour de cassation rappelle que cette transaction a été conclue par les deux parties en l’absence de notification du licenciement par voie de lettre recommandée avec avis de réception. De ce fait, il en résulte que la transaction est nulle.
La Jurisprudence part du principe qu’une transaction peut tout à fait être valable. Encore faut-il en fixer les contours. En la matière, la Cour de cassation vient apporter une lumière sur le formalisme devant entourer cette rupture afin de rendre la transaction valable.
La question qui était posée aux juges était ici de savoir si une transaction conclue après la notification d’un licenciement par remise en main propre était ou non valable.
Pour répondre à cette question, les juges ont établi que cette transaction, afin d’être valable, doit être conclue après la notification du licenciement par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception. En l’absence de ce formalisme, la transaction est donc considérée comme nulle. Une simple remise en main propre au salarié, même contre signature, ne suffit pas.
Cette solution respecte tout particulièrement le formalisme tel qu’imposé par l’article L. 1232-6 du Code du travail et selon lequel l’employeur est tenu de notifier le licenciement au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception.
Une volonté de protéger le salarié licencié
Cette position de la part des juges n’est pas isolée. En effet, elle vient confirmer sa position constante, notamment dans un arrêt rendu le 5 mai 2010.
On pourrait légitimement se demander quelles sont les raisons d’une telle décision, dans la mesure où on pourrait penser qu’une remise en main propre suffit pour que le salarié prenne connaissance de son licenciement. En réalité, il apparaît que l’avantage de l’envoi par lettre recommandée avec avis de réception est de permettre au salarié licencié d’avoir une pleine et entière connaissance des motifs de son licenciement. Or, cela n’est pas forcément le cas lorsque le licenciement est notifié au salarié par une remise en main propre. L’objectif des juges est donc de protéger le salarié licencié, la transaction ayant pour conséquence de rendre impossible toute contestation. Cela ne remet nullement en cause la validité de tout licenciement mais bien de toute transaction conclue après le licenciement. Il est ainsi acquis de manière constante que la notification au salarié de son licenciement par une lettre remise en main propre ne requalifie pas le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il est donc hautement conseillé aux employeurs de notifier le licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception afin de pouvoir conclure une transaction postérieurement.
![]()

Fraude à la TVA : Le principe et les risques de redressement fiscal
Fraude à la TVA : Le principe et les risques de redressement fiscal
La fraude fiscale est définie par le Code général des impôts (article 1741) comme le fait de se soustraire ou tenter de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement total ou partiel des impôts. Étendue à la TVA, la fraude à la TVA consiste donc pour un contribuable d’échapper de manière volontaire et frauduleuse, caractérisant en outre la mauvaise foi, aux obligations de collecte en matière de TVA. Pénalement répréhensible, elle représente un manque à gagner pour l’État d’environ 14 milliards d’euros, poussant ainsi Bercy à multiplier les contrôles et les redressements face aux situations frauduleuses relevées par ses agents.
Principe de la fraude à la TVA
Toute personne morale qui importe et/ou vend une prestation de services ou un bien collecte de la TVA (taxe sur la valeur ajoutée) qu’elle doit ainsi reverser à l’État. La fraude à la TVA est constituée par l’absence de reversement des montants dus à l’État (partiellement ou totalement), représentant ainsi juridiquement un enrichissement sans cause, notion issue de la jurisprudence avant sa codification dans le Code civil.
La fraude à la TVA peut parfois masquer de véritables montages frauduleux caractérisant la mauvaise foi, à travers la constitutions de société éphémères ou fictives, voire des montages. La fraude peut donc être simple ou plus complexe, constituer une simple erreur de bonne foi (mauvaise connaissance des règles, notamment sur les régimes spécifiques de TVA réduite, par exemple) ou à l’inverse démontrer l’intention manifeste de frauder.
La fraude à la TVA peut également être constituée lorsqu’une entreprise importe des produits provenant d’un pays étranger membre de l’Union européenne sans payer de TVA (exonération de TVA intracommunautaire), tout en collectant une TVA à la revente, non versée à l’État. Enfin, la fraude peut être plus élaborée, et s’organiser entre plusieurs entités afin d’obtenir remboursement par un État de l’Union d’une TVA jamais collectée, ou d’en réduire le montant.
Comment s’organise la lutte et la sanction des fraudes à la TVA ?
Face au manque à gagner considérable, mais également à l’enrichissement sans cause des fraudeurs sur une TVA devant revenir à l’État, collecté sur le dos des acquéreurs, et non reversé, le Ministère de l’économie a décidé de lancer une offensive de lutte contre ces comportements frauduleux, à travers un plan en 3 volets, comportant des sanctions qui peuvent s’avérer dissuasives, mais également un système de dénonciation rémunérée, et des contrôles renforcés.
Le Code général des impôts prévoit une sanction lourde pour le délit de fraude à la TVA, de part une amende pouvant atteindre 75 000€ ainsi qu’une peine d’emprisonnement de 5 ans pour la personne physique ou le représentant légal de la personne morale en cause. Il est également possible de caractériser le délit d’escroquerie défini et sanctionné à travers les dispositions du Code pénal.
La loi 2016-1917 du 29 décembre 2016 adoptée en vue de la loi de finances 2017 constitue un fait marquant du plan de lutte gouvernemental contre la fraude à la TVA, grâce à la rémunération désormais instaurée pour les dénonciations permettant aux services administratifs de Bercy de constater et établir une fraude. Le montant de cette rémunération est fixé par le directeur général des Finances publiques, sur proposition du directeur de la direction des enquêtes fiscales (DNEF), et tient compte de l’ampleur de la fraude dénoncée.
Enfin, notons qu’un volet numérique a été instauré dans le cadre de la lutte contre la fraude à la TVA, à travers l’obligation d’usage de logiciels sécurisés et certifiés (article 88 de la loi de finances 2016) par l’Administration fiscale. L’absence d’attestation ou d’usage d’un logiciel de facturation agréé peut entraîner une amende de 7 500€. Enfin, Bercy s’est doté d’un logiciel de détection des fraudes utilisant un mécanisme d’algorithme précis, basé sur les éléments composant généralement les fraudes constatées, et utilisant donc l’expérience acquise par les inspecteurs.
![]()
