
L’impact de la médiation sur les procédures pénales : Équilibre entre la rapidité et la justice
La médiation sur les procédures pénales s’impose de plus en plus comme un outil efficace pour résoudre les conflits sans recourir aux longues et coûteuses procédures judiciaires. Cette approche alternative vise à offrir une résolution des litiges plus humaine et efficiente, mais elle soulève des questions cruciales. Comment assurer que la médiation ne compromet pas la justice, surtout pour les victimes de crimes graves ? Comment garantir un accès équitable à tous, y compris les personnes les plus vulnérables ? Cet article explore les différentes facettes de la médiation sur les procédures pénales, en évaluant son impact sur la rapidité et l’efficacité des procédures, les défis d’un accès égal pour tous, et le rôle fondamental du médiateur dans ce processus.
Rapidité et efficacité de la médiation
La médiation sur les procédures pénales offre des avantages considérables en termes de rapidité et de réduction des coûts. Contrairement aux démarches judiciaires traditionnelles, souvent longues et coûteuses, la médiation permet de résoudre les différends de manière plus expéditive. Les articles 763-1 à 763-4 du Code de procédure pénale soulignent que la médiation peut traiter certains délits rapidement, allégeant ainsi la charge des tribunaux. Les délais de traitement des affaires pénales diminuent significativement grâce à cette approche.
Cette rapidité est particulièrement bénéfique dans des contextes dans lesquels les ressources judiciaires sont limitées. Les économies réalisées grâce à la réduction des coûts de procédure permettent également de libérer des fonds pour d’autres aspects du système judiciaire, contribuant ainsi à une gestion plus efficace des affaires pénales. En outre, la médiation sur les procédures pénales favorise un dialogue direct entre les parties, facilitant la compréhension mutuelle et l’atteinte d’accords satisfaisants pour tous.
Équilibre entre rapidité et justice
Cependant, l’efficacité de la médiation ne doit pas se faire au détriment de la justice. Il est crucial que les droits des victimes, en particulier celles des crimes graves, soient pleinement respectés. La médiation sur les procédures pénales doit garantir que la rapidité de la résolution des conflits n’entraîne pas une minimisation de la gravité des infractions ou une évasion des sanctions pénales appropriées.
La Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 relative à la médiation précise que cette méthode doit être menée de manière impartiale et équitable. La transparence et l’équité sont des éléments essentiels pour assurer que les décisions prises reflètent les intérêts de toutes les parties impliquées. L’arrêt de la Cour de cassation du 21 mars 2019 réaffirme l’importance de ces principes, rappelant que la justice ne doit jamais être sacrifiée pour la rapidité.
Il est également essentiel de veiller à ce que la médiation sur les procédures pénales ne devienne pas un instrument permettant aux auteurs de crimes d’échapper aux conséquences de leurs actes. Les médiateurs doivent être vigilants pour que chaque partie comprenne pleinement les implications des accords et que ces accords respectent les droits et les intérêts de chacun.
Accès égal à la médiation
Un autre enjeu crucial de la médiation sur les procédures pénales est l’accès égal pour toutes les parties. Les personnes défavorisées ou vulnérables doivent avoir les mêmes opportunités d’accès à la médiation que les autres citoyens. Le rapport de la Commission nationale de la médiation de 2020 met en lumière les disparités existantes et propose des mesures pour les réduire.
Il est impératif que des ressources adéquates soient allouées pour soutenir les parties les plus défavorisées. Cela peut inclure des subventions pour les frais de médiation ou la formation des médiateurs pour qu’ils soient plus sensibles aux besoins spécifiques des populations vulnérables. L’égalité d’accès est essentielle pour garantir que la médiation sur les procédures pénales soit perçue comme une solution juste et équitable par tous.
La formation des médiateurs doit également inclure des modules sur les dynamiques de pouvoir et les biais implicites, afin de s’assurer que les processus de médiation sur les procédures pénales ne reproduisent pas les inégalités sociales existantes. En outre, des campagnes de sensibilisation peuvent être menées pour informer les citoyens sur leurs droits et les moyens d’accéder à la médiation.
Rôle et responsabilités du médiateur
Le médiateur joue un rôle central dans la médiation sur les procédures pénales. Il doit à la fois faciliter la communication entre les parties, et s’assurer que le processus est équitable et impartial. Les médiateurs doivent être formés pour encadrer les dynamiques de pouvoir entre les parties et pour s’assurer que les décisions prises sont conformes aux principes de justice.
La responsabilité du médiateur est de veiller à ce que chaque partie ait une voix égale dans le processus et que les solutions trouvées soient justes et équilibrées. Ils doivent également être capables de reconnaître et de gérer les situations auxquelles une partie pourrait tenter d’exercer une pression indue sur l’autre. La formation continue et la supervision des médiateurs peuvent aider à maintenir des standards élevés de pratique professionnelle.
Les médiateurs doivent par ailleurs être conscients de l’impact émotionnel de la médiation sur les procédures pénales sur les parties impliquées. Les victimes de crimes graves, en particulier, peuvent avoir besoin d’un soutien supplémentaire pour participer pleinement et équitablement au processus. Le médiateur doit être capable d’identifier ces besoins et de s’assurer que des mesures appropriées sont prises pour y répondre.
La médiation sur les procédures pénales présente des avantages significatifs en termes de rapidité et d’efficacité, mais elle doit être mise en œuvre avec soin pour ne pas compromettre la justice. Il est essentiel de garantir que tous les citoyens, indépendamment de leur statut social ou économique, aient un accès égal à la médiation. Le rôle du médiateur est central pour assurer que le processus est équitable et respecte les droits de toutes les parties.
Lire la suite
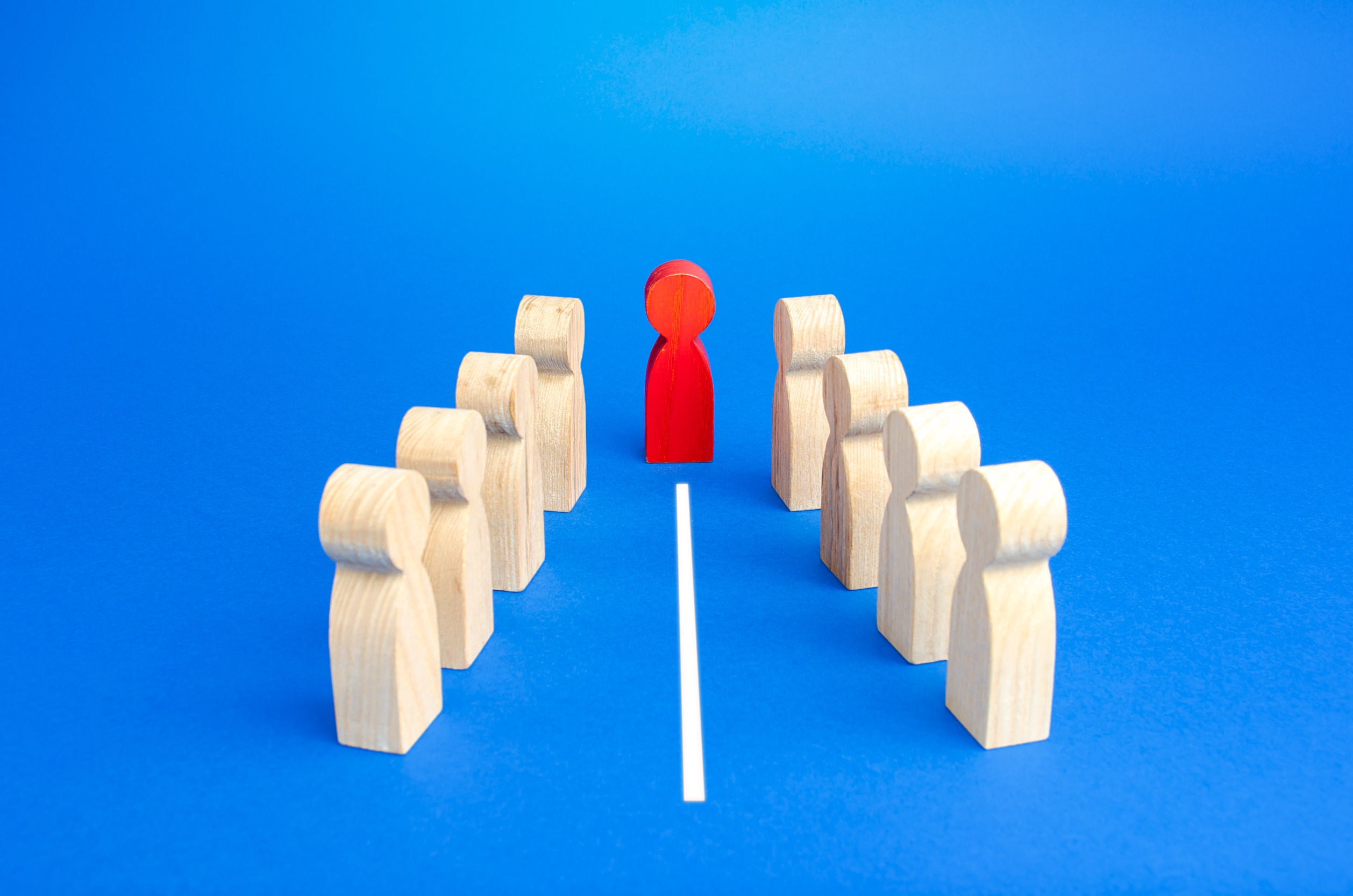
La médiation juridique et à la consommation
Introduction
Dans un monde où les conflits sont inévitables, qu’ils soient d’ordre personnel, professionnel ou commercial, la recherche de solutions pacifiques et constructives est primordiale. C’est dans ce contexte que la médiation émerge comme une alternative puissante aux procédures judiciaires traditionnelles.
La médiation, loin d’être une simple mode passagère, s’inscrit dans une démarche de résolution de conflits qui privilégie le dialogue, l’écoute et la recherche de solutions mutuellement bénéfiques. Elle repose sur un processus structuré où un tiers impartial, le médiateur, facilite la communication entre les parties en litige, les aidant à identifier leurs besoins, à comprendre ceux de l’autre partie et à élaborer ensemble des solutions adaptées.
Opter pour la médiation, c’est choisir une voie qui reconnaît la valeur de chaque individu et la possibilité de trouver un terrain d’entente, même dans des situations apparemment inextricables. C’est une approche qui, contrairement aux tribunaux, ne cherche pas à désigner un gagnant et un perdant, mais vise plutôt à créer une situation gagnant-gagnant pour toutes les parties impliquées.
La popularité croissante de la médiation dans le règlement des litiges n’est pas surprenante. Dans un monde de plus en plus complexe, où les relations interpersonnelles et commerciales sont souvent tendues, la médiation offre une bouffée d’air frais. Elle permet de désamorcer les tensions, de rétablir la confiance et, surtout, de préserver des relations précieuses.
La médiation n’est pas seulement une alternative aux procédures judiciaires, elle est une invitation à repenser notre manière d’aborder les conflits, en plaçant l’humain, le dialogue et la collaboration au cœur de la résolution des différends.
I. Qu’est-ce que la médiation ?
Définition de la médiation
La médiation est un processus volontaire et structuré par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord pour résoudre leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, qui facilite le dialogue et la recherche de solutions. Contrairement à un juge ou à un arbitre, le médiateur ne prend pas de décision pour les parties, mais les guide dans leur quête d’une résolution mutuellement satisfaisante.
Présentation du rôle du médiateur
Le médiateur est un professionnel formé pour faciliter la communication entre les parties en litige. Son rôle n’est pas de juger, de donner des conseils ou de prendre parti, mais de créer un environnement propice au dialogue. Il aide les parties à clarifier leurs besoins, à comprendre ceux de l’autre et à explorer des solutions potentielles. Le médiateur pose des questions, reformule, synthétise et, si nécessaire, propose des pistes de réflexion, tout en veillant à ce que chaque partie ait l’opportunité de s’exprimer pleinement.
Les principes fondamentaux de la médiation
- Confidentialité : La médiation est un processus privé. Tout ce qui est dit pendant la médiation reste confidentiel et ne peut être utilisé ultérieurement devant un tribunal ou dans d’autres contextes, sauf accord contraire des parties. Cette confidentialité encourage l’ouverture et l’honnêteté, permettant aux parties de discuter librement sans craindre que leurs paroles soient utilisées contre elles.
- Impartialité : Le médiateur ne prend pas parti. Il ne favorise aucune des parties et veille à ce que chacune soit traitée équitablement. Son rôle est de faciliter le dialogue, sans préjugés ni favoritisme.
- Neutralité : Le médiateur ne donne pas de conseils ni ne propose de solutions. Il reste neutre face au contenu du litige, se concentrant sur le processus de médiation lui-même. C’est aux parties de trouver une solution, le médiateur étant là pour les guider dans cette démarche.
En respectant ces principes fondamentaux, la médiation offre un cadre sécurisé et bienveillant, où les parties peuvent s’exprimer librement, explorer des solutions et, idéalement, parvenir à un accord qui répond à leurs besoins respectifs.
II. Avantages de la médiation
Résolution rapide des conflits
La médiation est souvent beaucoup plus rapide que les procédures judiciaires traditionnelles. Alors qu’un procès peut s’étendre sur plusieurs mois, voire plusieurs années, la médiation peut souvent aboutir à une résolution en quelques séances. Cette rapidité est bénéfique pour les parties qui peuvent ainsi passer à autre chose et éviter le stress prolongé d’un litige en cours.
Moins coûteux que les procédures judiciaires
Les coûts associés à la médiation sont généralement bien inférieurs à ceux d’une action en justice. Les honoraires des médiateurs, même s’ils peuvent sembler importants au départ, sont souvent compensés par l’économie réalisée en évitant les frais judiciaires, les honoraires d’avocats pour une longue procédure, et autres coûts associés à un procès.
Confidentialité préservée
Contrairement aux procès qui sont souvent publics, la médiation est un processus privé et confidentiel. Les détails du litige et les discussions qui ont lieu pendant la médiation ne sont pas rendus publics. Cette confidentialité permet aux parties de discuter ouvertement et honnêtement de leurs préoccupations sans craindre que l’information ne soit divulguée à l’extérieur.
Renforcement des relations entre les parties
La médiation, en encourageant le dialogue et la compréhension mutuelle, peut aider à préserver ou même à renforcer les relations. C’est particulièrement important dans les situations où les parties ont une relation continue, comme dans les litiges familiaux ou commerciaux. En trouvant une solution ensemble, les parties peuvent rétablir la confiance et la communication, ce qui est souvent difficile dans le cadre d’un procès adversarial.
Solutions sur mesure adaptées aux besoins des parties
L’un des plus grands avantages de la médiation est la capacité des parties à créer des solutions sur mesure qui répondent spécifiquement à leurs besoins et préoccupations. Contrairement à une décision judiciaire qui peut être limitée par les lois et les précédents, la médiation offre une flexibilité permettant aux parties de trouver des solutions créatives et adaptées à leur situation unique.
En somme, la médiation offre une alternative attrayante aux procédures judiciaires traditionnelles, offrant une approche plus rapide, moins coûteuse, et plus centrée sur les besoins et préoccupations des parties. Elle reconnaît l’importance des relations humaines et vise à trouver des solutions qui bénéficient à tous les participants.
III. La médiation à la consommation
Définition et contexte
La médiation à la consommation est un processus par lequel un consommateur et un professionnel tentent, avec l’aide d’un médiateur, de trouver une solution amiable à un litige qui les oppose. Elle intervient généralement dans le cadre de litiges liés à la vente de biens ou à la fourniture de services. En Europe, notamment en France, la médiation à la consommation a été renforcée par des directives et des réglementations visant à offrir aux consommateurs des mécanismes de résolution des litiges plus accessibles et efficaces que les procédures judiciaires traditionnelles.
Quand et pourquoi recourir à la médiation à la consommation ?
Recourir à la médiation à la consommation est particulièrement pertinent lorsque :
- Les voies de recours internes auprès du professionnel (service client, réclamations) n’ont pas abouti à une solution satisfaisante.
- Le consommateur souhaite éviter une procédure judiciaire longue et coûteuse.
- Les deux parties sont ouvertes à la recherche d’une solution amiable et souhaitent préserver leur relation commerciale.La médiation à la consommation est souvent privilégiée pour sa rapidité, son faible coût (voire sa gratuité pour le consommateur) et sa capacité à trouver des solutions adaptées aux besoins spécifiques des parties.
Avantages spécifiques de la médiation à la consommation
- Rapidité : Les litiges à la consommation peuvent souvent être résolus en quelques semaines, voire quelques jours, grâce à la médiation.
- Coût : La médiation à la consommation est souvent gratuite pour le consommateur, les frais étant pris en charge par le professionnel ou par des organismes dédiés.
- Flexibilité : Les solutions proposées peuvent être adaptées à la situation spécifique du litige, offrant des réparations, des remboursements, des échanges ou d’autres formes de dédommagement.
- Préservation de la relation : La médiation permet de résoudre le litige tout en préservant la relation entre le consommateur et le professionnel, ce qui peut être bénéfique pour les futures interactions.
Exemples de litiges couramment résolus par la médiation à la consommation
- Produits défectueux : Un consommateur achète un appareil électroménager qui tombe en panne peu après l’achat.
- Services non conformes : Un client n’est pas satisfait de la prestation d’un artisan ou d’un service fourni (par exemple, travaux de rénovation, services de télécommunication).
- Problèmes de garantie : Un produit cesse de fonctionner pendant la période de garantie, mais le vendeur refuse de le réparer ou de le remplacer.
- Litiges liés aux voyages : Problèmes avec une réservation d’hôtel, un vol annulé ou des prestations touristiques non conformes à ce qui était promis.
- Facturation et paiement : Des désaccords sur des frais inattendus, des prélèvements non autorisés ou des litiges liés à des contrats d’abonnement.
La médiation à la consommation offre une voie efficace et avantageuse pour résoudre de nombreux types de litiges entre consommateurs et professionnels, en privilégiant le dialogue et la recherche de solutions amiables.
IV. Comment se déroule une médiation ?
Phase préliminaire : choix du médiateur et préparation
Avant de commencer le processus de médiation, il est essentiel de choisir le bon médiateur. Le médiateur doit être neutre, impartial et posséder l’expertise nécessaire pour comprendre le litige. Les parties peuvent choisir un médiateur par le biais d’organismes de médiation reconnus ou sur recommandation.
Une fois le médiateur choisi, une première rencontre est organisée pour définir le cadre de la médiation : les règles de confidentialité, le rôle de chacun, et les attentes des parties. Cette phase préliminaire permet également de recueillir les informations essentielles sur le litige et de préparer les parties à la médiation.
Phase de médiation : discussions, négociations et recherche de solutions
La phase de médiation commence véritablement lorsque les parties se réunissent, en présence du médiateur, pour discuter du litige. Le médiateur facilite la communication, aide les parties à exprimer leurs besoins et préoccupations, et veille à ce que le dialogue reste constructif.
Les parties explorent ensemble les différentes options possibles pour résoudre le litige. Le médiateur peut proposer des pauses, des entretiens individuels ou des sessions de brainstorming pour aider à la recherche de solutions.
Conclusion de la médiation : accord amiable et mise en œuvre
Si les parties parviennent à un accord, celui-ci est généralement consigné par écrit. Cet accord peut avoir une valeur contractuelle et être exécutoire, à condition qu’il respecte les dispositions légales en vigueur. Il détaille les engagements de chaque partie, les modalités de mise en œuvre et, le cas échéant, les sanctions en cas de non-respect.
Il est important de noter que l’accord issu de la médiation est basé sur le consentement mutuel des parties, ce qui augmente les chances de sa mise en œuvre effective et durable.
Si la médiation échoue : quelles alternatives ?
Il arrive que la médiation ne débouche pas sur un accord. Dans ce cas, plusieurs alternatives sont possibles :
- Arbitrage : Une forme de résolution des litiges où un tiers neutre, l’arbitre, prend une décision qui est généralement contraignante pour les parties.
- Conciliation : Similaire à la médiation, mais le conciliateur joue un rôle plus actif dans la proposition de solutions.
- Procédure judiciaire : Si aucune solution amiable n’est trouvée, les parties peuvent décider de porter le litige devant les tribunaux.
- Négociation directe : Les parties peuvent continuer à négocier entre elles, sans l’intervention d’un tiers, pour tenter de trouver une solution.
En conclusion, la médiation est un processus structuré qui offre une alternative aux procédures judiciaires traditionnelles. Elle privilégie le dialogue, la recherche de solutions amiables et le respect des intérêts de chacun. Si elle échoue, d’autres voies de résolution des litiges restent ouvertes aux parties.
V. Choisir le bon médiateur
Qualités et compétences d’un bon médiateur
Un bon médiateur possède une combinaison de qualités personnelles et de compétences professionnelles qui lui permettent de faciliter efficacement la résolution de conflits.
- Neutralité : Le médiateur ne doit avoir aucun intérêt personnel dans l’issue du litige et ne doit favoriser aucune des parties.
- Impartialité : Il doit traiter toutes les parties avec équité, sans préjugés ni favoritisme.
- Écoute active : La capacité d’écouter attentivement, de comprendre et de refléter les préoccupations de chaque partie est essentielle.
- Excellentes compétences en communication : Le médiateur doit être capable de faciliter le dialogue, de reformuler les points de vue et d’aider les parties à exprimer leurs besoins et préoccupations.
- Empathie : Bien que neutre, le médiateur doit être capable de comprendre les émotions et les préoccupations des parties, ce qui peut aider à établir un climat de confiance.
- Confidentialité : Le médiateur doit garantir que tout ce qui est dit pendant la médiation reste confidentiel, sauf accord contraire des parties.
Formation et certification des médiateurs
La profession de médiateur nécessite une formation spécifique qui couvre les principes fondamentaux de la médiation, les techniques de communication, la gestion des conflits et la déontologie.
- Formation initiale : De nombreux pays proposent des formations certifiantes en médiation, généralement organisées par des institutions reconnues ou des associations professionnelles.
- Certification : Après avoir suivi une formation, les médiateurs peuvent obtenir une certification qui atteste de leurs compétences et de leur expertise. Cette certification peut nécessiter des examens, des évaluations pratiques et un engagement en matière de formation continue.
- Formation continue : Un bon médiateur continue de se former tout au long de sa carrière pour rester à jour sur les meilleures pratiques, les évolutions légales et les nouvelles techniques de médiation.
Comment trouver et sélectionner un médiateur adapté à son litige
- Recherche en ligne : De nombreux pays disposent de registres ou d’annuaires en ligne de médiateurs certifiés. Ces plateformes permettent souvent de filtrer les médiateurs par spécialité, localisation ou expérience.
- Recommandations : Demander des recommandations à des amis, des collègues ou des professionnels du droit peut être un bon moyen de trouver un médiateur de confiance.
- Associations professionnelles : Les associations de médiateurs peuvent fournir des listes de membres, organiser des événements de mise en réseau ou offrir des services de médiation.
- Entretien préliminaire : Avant de choisir un médiateur, il peut être utile de planifier un entretien préliminaire pour discuter du litige, comprendre l’approche du médiateur et évaluer sa compatibilité avec les parties.
Choisir le bon médiateur est une étape cruciale pour garantir le succès de la médiation. Il est essentiel de prendre le temps de rechercher, d’évaluer et de sélectionner un professionnel qui possède les qualités, les compétences et l’expertise nécessaires pour faciliter la résolution du litige.
Conclusion
Au fil de cet article, nous avons exploré en profondeur la médiation, une alternative puissante aux procédures judiciaires traditionnelles. Nous avons abordé sa définition, son processus, les qualités essentielles d’un bon médiateur, et les spécificités de la médiation à la consommation.
La médiation se distingue par sa capacité à offrir des solutions sur mesure, adaptées aux besoins et préoccupations des parties en conflit. Elle mise sur le dialogue, l’écoute et la recherche de compromis, permettant ainsi de préserver, voire de renforcer, les relations entre les parties.
Nous encourageons vivement toute personne confrontée à un litige à considérer la médiation comme une option viable. Non seulement elle peut s’avérer moins coûteuse et plus rapide que les procédures judiciaires, mais elle offre également un cadre confidentiel et neutre pour trouver des solutions mutuellement bénéfiques.
Enfin, il est crucial de sensibiliser davantage le public à la médiation. Plus nous comprenons et valorisons cette approche, plus nous serons enclins à choisir des résolutions amiables, favorisant ainsi la paix et l’harmonie dans nos interactions personnelles et professionnelles.
Pour en savoir plus, ou si vous avez besoin de notre aide pour une médiation, n’hésitez pas à nous contacter.
Lire la suite
Processus de médiation : les 6 grandes étapes
Les 6 étapes majeures du processus de médiation
Mode de résolution des litiges à part entière, la médiation fait appel au consensus et utilise pour cela un panel de techniques destinées à parvenir à une entente entre les parties. La médiation est une procédure flexible, impliquant l’intervention du médiateur à chaque étape. Le cabinet Ake Avocats vous éclaire dans cet article sur les 6 grandes étapes du processus de médiation.
1 – L’introduction du médiateur dans le processus
Le médiateur se présente tout d’abord aux parties et explique son rôle dans le processus. Il peut d’ores et déjà évoquer les différentes étapes de la médiation, afin de rendre la démarche transparente.
A cette occasion, le médiateur en profite pour valider les informations communiquées afin d’organiser la première entrevue de médiation. Cette première étape est l’occasion de poser les jalons des réunions prévues et du processus de manière globale, afin de progresser dans les meilleures conditions.
2 – L’exposé de la demande
Dans cette seconde étape, le médiateur donne la parole à chaque partie à tour de rôle afin qu’elle puisse s’exprimer sur son histoire et sur ses ressentis personnels. Chaque médié fait le récit des faits, selon sa propre position. Le médiateur en profite pour recueillir un maximum d’informations importantes dans la suite du processus. Cela lui permet notamment de se faire une première idée des points de dissonance et de convergence sur lesquels il pourra axer son travail.
3 – L’engagement des parties à la médiation
En réalité il est impossible de parvenir à une résolution du litige sans l’obtention préalable de l’engagement des parties à la médiation. Conformément au Code national de déontologie des médiateurs, il est nécessaire de recueillir le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Ainsi, les médiateurs sont tenus de refuser une mission où le consentement est altéré.
4 – L’expression des difficultés existantes
Le processus de médiation s’organise en plusieurs étapes. Une fois qu’elles ont exprimé leur consentement, les parties expriment les points qui posent problème et répondent aux questions posées par le médiateur. Ce dernier en profite pour organiser les entretiens à venir, tant communs qu’individuels.
5 – La tenue des entretiens communs et individuels
Cette partie est cruciale puisque l’on rentre dans le vif du sujet. L’objectif du médiateur est de trouver des aspects communs entre les médiés, en tenant compte des difficultés parfois dissimulées qui peuvent ternir les relations entre les parties et créer des tensions. Le médiateur peut également tenir des entretiens individuels avec chaque partie.
6 – L’élaboration d’un accord entre les parties à la médiation
Une fois que les participants sont d’accord pour régler le conflit à l’amiable, le médiateur propose de réaliser une séance dédiée à l’exploration des solutions éventuelles permettant de trouver un accord final. L’objectif est d’éviter au litige de perdurer et de réfléchir le plus vite possible à une solution qui convienne à chaque partie. Le médiateur est à la fois diplomate et doué d’une grande psychologie puisqu’il cerne rapidement les points de friction et l’origine parfois cachée du conflit, cristallisé autour de certains éléments qu’il est important d’aborder en séance.
Spécialisé dans la médiation, le cabinet Ake Avocats est à votre disposition pour trouver un accord amiable à tout litige. N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations.
Lire la suite
Médiateur et conciliateur de justice : deux fonctions incompatibles ?
Médiateur et conciliateur de justice : deux fonctions incompatibles ?
Dans un arrêt du 15 décembre 2022, les juges sont revenus sur leur analyse de la compatibilité entre plusieurs fonctions judiciaires : celles de médiateur de justice et de conciliateur de justice. La Cour de cassation a ainsi précisé que ces deux fonctions étaient incompatibles, ce qui entraîne certaines conséquences en droit. Zoom avec Ake Avocats.
Pratique de la médiation et de la conciliation de justice : un flou juridique
Le juge est habilité à confier une mission de conciliation de justice à un tiers, alors chargé de tenter de régler un différend à l’amiable. Exerçant cette fonction à titre gratuit, le conciliateur est parfois tenté de s’inscrire pour exercer la mission de médiateur en parallèle. Bien souvent, cela pose difficulté puisque le droit est assez flou sur la question.
Par un arrêt en date du 15 décembre 2022, les juges ont tranché ce flou juridique en considérant qu’il est impossible d’exercer dans le même temps les fonctions de médiateur de justice et de conciliateur de justice.
Exception pour la fonction de médiateur de la consommation
En l’espèce, le requérant mettait en avant le fait qu’il est possible d’exercer la fonction de conciliateur de justice et de médiateur de la consommation dans le même temps. Il considérait donc que la réciproque était vrai concernant les fonctions de conciliateur et de médiateur de droit commun.
Les juges répondent par la négative en précisant que la fonction de médiateur de la consommation est une exception introduite par l’ordonnance n° 2015-1033 du 20 août 2015. Ainsi, il reste possible d’exercer à la fois la fonction de médiateur de la consommation et celle de conciliateur de justice.
Un champ des textes étendu
Conformément au décret n° 78-381 du 20 mars 1978, une personne exerçant une activité judiciaire ne peut pas être nommée conciliateur de justice. Ici la question se posait de savoir si une personne au préalable conciliatrice de justice pouvait ensuite s’inscrire comme médiateur de justice. Les juges étendent le champ du décret en y incluant ce dernier cas de figure. On en conclut qu’un individu déjà occupé par la fonction de conciliateur de justice ne peut pas être nommé médiateur de justice, par parallèle avec l’impossibilité en cas d’exercice d’une activité judiciaire. On suit donc ici une sorte de capillarité dans les solutions avec une extension du champ des textes. Cela, y compris si l’activité exercée n’est pas rémunérée et seulement occasionnelle.
Toutefois, cela peut amener à s’interroger sur la fonction de conciliateur de justice qui est nommé bénévolement contrairement au médiateur de justice généralement rémunéré. En effet, si le conciliateur ne peut pas cumuler son activité avec la fonction de médiateur, le risque est qu’il ne se lance pas dans cette activité. De son côté, la médiation reste très largement plébiscitée, d’autant plus depuis l’instauration du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 permettant au juge de solliciter une injonction de médiation.
Spécialisé dans la médiation, le cabinet Ake Avocats intervient dans le cadre de vos litiges et dans la résolution à l’amiable de vos différends avant toute action en justice.
Lire la suite
Inscription sur la liste des médiateurs : quelles conditions ?
Conditions exigées pour s’inscrire sur la liste des médiateurs
Le médiateur est une partie souvent indispensable dans de nombreux litiges. Il intervient en qualité d’autorité administrative indépendante et a pour mission de tout mettre en œuvre pour résoudre un différend à l’amiable, en phase pré-contentieuse. Au regard de ses nombreuses qualités et de son savoir-faire, le médiateur doit suivre un processus précis pour exercer. Le cabinet Ake Avocats vous éclaire dans cet article sur les conditions requises pour s’inscrire sur la liste des médiateurs.
Décret du 9 octobre 2017 et inscription des médiateurs sur une liste
L’article 2 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 vient fixer les conditions d’inscription des médiateurs sur une liste. En principe, cette liste est simplement utilisée comme information pour les juges. Toutefois, être inscrit sur la liste des médiateurs permet de gagner en visibilité et d’obtenir davantage de missions.
La question des conditions requises pour s’inscrire en tant que médiateur sur cette liste est donc souvent revenue sur le devant de la scène et a même fait naître un contentieux. En pratique, les juges doivent se tenir au texte et ne peuvent pas prévoir d’autres conditions supplémentaires que celles prévues dans le décret.
Une expérience ou une formation suffisante pour la pratique de la médiation
En pratique, le décret du 9 octobre 2017 dresse la liste des critères indispensables pour figurer sur la liste des médiateurs en service. Il faut d’une part pouvoir justifier d’une expérience ou d’une formation suffisante pour pratiquer la médiation.
En pratique, la Cour de cassation considère qu’il y a lieu d’apprécier le parcours du candidat et son aptitude générale à pratiquer la médiation. Cela, au regard de la formation qu’il a suivie et de son expérience globale au fil des années. Ainsi, si le candidat a suivi une formation à elle seule insuffisante, il peut toujours se rattraper par son expérience professionnelle.
Les juges ne peuvent donc pas refuser à un candidat de s’inscrire sur la liste des médiateurs en se basant uniquement sur une expérience insuffisante dans le secteur de la médiation. Il convient d’apprécier les deux critères pris globalement : d’une part l’expérience et d’autre part la formation.
Autres conditions exigées pour s’inscrire sur la liste des médiateurs
La personne qui souhaite proposer ses services en tant que médiateur doit réunir d’autres conditions cumulatives indispensables :
- ne pas avoir fait l’objet d’une déchéance, d’une incapacité ou d’une condamnation (vérification du bulletin n°2 du casier judiciaire),
- ne pas avoir accompli d’acte contraire à la probité, aux bonnes mœurs ou à l’honneur et ayant occasionné une sanction (administrative ou disciplinaire) comme une radiation, une destitution de fonctions, un retrait d’agrément ou une révocation,
Appréciation de l’indépendance et de l’impartialité du médiateur
La question s’est également posée de savoir comment apprécier l’indépendance et l’impartialité des médiateurs. En pratique, l’absence d’un risque de conflit d’intérêt n’est pas mentionnée dans le décret comme condition d’inscription sur la liste des médiateurs. Cela ne signifie pas que l’impartialité du médiateur est mise de côté, toutefois cette condition doit être considérée au moment de la désignation du médiateur.
L’impartialité et l’indépendance de ce professionnel dépendent du litige pour lequel il est contacté. Ces éléments sont donc considérés lorsque le médiateur est investi de sa mission sur un différend en particulier. Cela ne doit pas être confondu avec la liste des médiateurs, dressée uniquement pour information des juges.
Spécialisé en droit de la médiation, le cabinet Ake Avocats est à votre disposition pour vous accompagner en phase pré-contentieuse et vous aider à résoudre rapidement un litige à l’amiable en défendant au mieux vos intérêts.
Lire la suite
Médiation préalable obligatoire : quel est le bilan ?
Quel bilan pour la médiation préalable obligatoire ?
La loi Justice du XXIe siècle en date du 18 novembre 2016 a prévu l’expérimentation de la médiation préalable obligatoire. Après plusieurs années au banc d’essai, l’heure est au compte-rendu. Quel bilan le Conseil d’Etat fait-il de l’utilisation de cette médiation préalable obligatoire ? Eclairage avec le cabinet Ake Avocats.
Un bilan plutôt positif mais des disparités entre les administrations
L’objectif de la médiation préalable obligatoire était d’élargir le dispositif et de le pérenniser au maximum pour certains contentieux. On dénombre ainsi 5 516 demandes de médiation préalable obligatoire enregistrées entre le 1er avril 2018 et le 1er avril 2021. Le tout avec un taux de réussite avoisinant les 76 %.
Dans les faits, plus de 80 % des demandes de médiation ont concerné des litiges sociaux. La moitié des litiges visant Pôle Emploi. La totalité des demandes envoyées aux médiateurs de Pôle emploi étaient recevables tandis qu’un peu moins de la moitié l’était concernant les CDG (ou centres de gestion de la fonction publique territoriale).
Face à ce résultat communiqué par le Conseil d’Etat, la première réaction est à l’enthousiasme. Pour autant, ce bilan est quelque peu terni par la présence de disparités importantes entre les administrations et les territoires. Puisque l’expérimentation doit se terminer le 31 décembre 2021, la question se pose de maintenir le dispositif de médiation préalable obligatoire plus longtemps. En prenant bien entendu en compte l’importance de diminuer ces disparités.
Un taux de réussite variable en fin de médiation
Une médiation préalable obligatoire est dite réussie lorsqu’elle a débouché sur un accord. Au sein du ministère des Affaires étrangères, ce taux dépasse les 80 %, tandis qu’il n’est que de 51 % dans la fonction publique territoriale. De manière globale, on estime que plus de la moitié des médiations aboutit à une issue favorable. Cela a évidemment pour conséquence d’alléger les tribunaux et les flux contentieux.
Du côté de la célérité de la justice, l’impact du taux de réussite de la médiation obligatoire se fait ressentir. La médiation se règle en moyenne en 52 jours au sein du ministère de l’Education nationale, contre 90 jours environ au ministère des Affaires étrangères.
Vers un développement d’une culture de la médiation
Face aux résultats de cette étude, plusieurs axes d’amélioration ont été avancés. Notamment celui de développer davantage une culture de la médiation. Si l’essai de la médiation est obligatoire, les parties restent tout de même libres de pouvoir continuer le processus ou d’y mettre un terme. Développer cette culture de la médiation apparaît donc comme un atout à l’avantage premier des agents et des administrations. Des sessions de formation peuvent par exemple être menées en ce sens.
De leur côté, les médiateurs doivent rester formés, légitimes, impartiaux, disponibles et indépendants. Le tout avec une dose de pédagogie à chaque étape.
Quoi qu’il en soit, la médiation reste une voie efficace et pertinente dans le maintien des relations pérennes entre l’employeur public et son agent. Le tout en gagnant un temps précieux et en parvenant souvent à trouver un accord satisfaisant pour toutes les parties.
Spécialisé dans le droit de la médiation, le cabinet Ake Avocats basé à La Réunion propose aux particuliers et aux entreprises de défendre leurs droits par le biais de la médiation ou de l’action judiciaire.
Lire la suite
Décret du 29 janvier 2021 : nouveautés pour la médiation en ligne
Décret du 29 janvier 2021 : quelles modifications pour la certification des services de médiation en ligne ?
Le décret n° 2021-95 du 29 janvier 2021 apporte quelques modifications quant à la certification des services en ligne de conciliation, de médiation et d’arbitrage. Les contours de l’accès à ces services sont revisités pour une meilleure prise en charge. On assiste également à du nouveau pour les médiateurs de la consommation et les autres conciliateurs. Zoom sur les nouveautés de ce décret.
Les médiateurs et les conciliateurs sont désormais certifiés de plein droit
Les médiateurs de la consommation, les médiateurs proposant leurs services en ligne et les conciliateurs de justice sont désormais certifiés de plein droit.
Ils n’ont donc plus besoin de demander une certification par un organisme spécifique car ils en bénéficient automatiquement. Néanmoins, le document justifiant de cette certification effective, doit être visible par tous, dans une logique d’information et de transparence.
Les médiateurs qui ne sont pas inscrits sur les listes de médiateurs en Cours d’appel continuent sous le régime précédent. Ces derniers doivent donc continuer à faire une demande de certification auprès d’un organisme agréé. La différence entre ces deux types de prestataires réside dans leur inscription ou non sur la liste de médiateurs près une Cour d’appel. La certification n’est cependant pas une obligation mais un gage de fiabilité pour les justiciables.
Pour permettre aux justiciables de savoir quels prestataires sont certifiés, la Chancellerie a instauré le label “Certilis”. Ce label représente une garantie de qualité et de fiabilité pour les services de médiation, d’arbitrage et de conciliation en ligne. En choisissant un prestataire garanti “Certilis”, le demandeur sait qu’il se tourne vers un service en ligne qui obéit aux obligations légales en vigueur.
Création d’une rubrique spécifique pour les services de médiation en ligne
Autre ajout de ce décret : la création d’une rubrique spéciale pour les services de médiation en ligne. Toutes les personnes qui proposent un accès à la médiation ou à la conciliation en ligne doivent remplir les conditions de la loi Belloubet. Il s’agit notamment des conditions suivantes :
- les données personnelles sont protégées et restent confidentielles, hormis si les parties expriment leur accord écrit
- le médiateur doit fournir une information détaillée sur la résolution amiable du litige et sur l’impossibilité d’avoir exclusivement recours au traitement automatisé de données personnelles
Un audit de suivi à distance pour les services de médiation en ligne
Tout service de médiation, de conciliation et d’arbitrage en ligne doit faire l’objet d’un audit de suivi. Si possible, réalisé à distance. Dans ce cadre, le transfert d’une certification à un autre organisme est réalisable. Le tout dans une logique de bon suivi et de libre concurrence.
Si le prestataire se voit opposer un refus, un retrait ou une suspension de sa certification par l’organisme, il peut exercer un recours interne. L’instance se prononce sur son dossier dans un délai de 4 mois à compter de la réception de sa demande. Le recours interne n’empêche pas de mener un recours en justice contre la décision prise par l’organisme de certification.
Vous souhaitez avoir recours à la médiation pour résoudre un différend ? Ake Avocats vous propose son aide dans le cadre d’une médiation fiable et de qualité.
Lire la suite
Médiation : Comment gérer ses problèmes de voisinage
Médiation : Comment gérer ses problèmes de voisinage
Comme prévu dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, « La liberté consiste à faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ». Et pourtant, on estime que 2 français sur 3 subissent ou subiront un jour des nuisances de voisinage, véritable fléau de la densification croissante des villes et campagnes. S’il est souvent considéré qu’elles constituent une fatalité fasse à laquelle il est difficile d’agir, le droit ne demeure pas en reste et offre des possibilités d’action permettant de faire valoir ses droits, et cesser ces problématiques qui sont parfois susceptibles de dégrader fortement votre quotidien, privant les victimes d’une jouissance paisible de leur logement qu’il s’agisse d’une maison ou d’un appartement. Car si ce phénomène touche davantage les copropriétaires, il n’épargne pas les logements individuels et les quartiers pavillonnaires.
La jurisprudence au secours de la quiétude au quotidien
C’est à travers un arrêt rendu le 19 novembre 1986 que la 2e chambre civile de la Cour de cassation est venue créer la notion de trouble anormal de voisinage (pourvoi 84-16.379): “Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage”, instaurant un double principe d’exonération de responsabilité pour le résident dont les activités demeurent en-deçà d’un seuil de tolérance, alors que la 2e permet l’engagement automatique de la responsabilité de celui qui dépasse ce même seuil : le fait générateur est ainsi plus important que le préjudice en lui-même.
En effet, la vie en communauté pousse à établir un rapport d’équilibre entre les nuisances rendues nécessaires par la vie quotidienne (qu’elles soient sonores, visuelles ou olfactives). L’abus de droit de propriété et le trouble anormal de voisinage sont ainsi caractérisés lorsque cet équilibre est rompu, et ce même si aucune faute caractérisée n’est commise. La Cour d’appel d’Amiens est venue préciser dans un ancien arrêt de 1932 que nul n’est en droit d’imposer à ses voisins « une gêne excédant les obligations ordinaires du voisinage ». De la musique à fond à toute heure, aux hurlements répétés, bruits de meubles ou de coups intempestifs, barbecue sur le balcon, commerce ou activités mitoyennes bruyantes… les exemples possibles sont nombreux.
Quelle procédure engager face aux troubles de voisinage ?
La première démarche à engager est bien entendu amiable. Il est possible qu’avec un simple dialogue les choses puissent rentrer dans l’ordre, et que le voisin responsable des nuisances n’ait tout simplement pas conscience (volontairement ou non) du préjudice qu’il provoque. Si le dialogue verbal ne suffit pas, il convient alors de constituer un dossier écrit à travers l’envoi dans un premier temps d’un courrier simple, suivi d’une mise en demeure avec rappel de la législation (notons ici que le tapage diurne est tout aussi prohibé que le tapage nocturne!) par courrier recommandé avec accusé de réception si la situation n’évolue pas favorablement.
Lorsque cette première phase directe entre la victime et le responsable des nuisances ne suffit pas, il est alors possible de faire appel à un médiateur, dont la saisie s’effectue directement en mairie. Ce médiateur convoque alors les parties et tente depuis son regard extérieur et en terrain neutre de trouver une solution durable. Mais il ne dispose d’aucun pouvoir de police ou même de contrainte : il ne peut obliger les parties à se rendre à sa convocation. Si la démarche reste amiable, son caractère plus officiel permet généralement de régler le conflit.
Le troisième recours possible en cas d’échec est alors le maire de la commune, garant de la tranquillité publique et en mesure de diligenter les moyens nécessaires pour constater et faire cesser le trouble, notamment grâce aux forces de police municipale (police du quotidien et du cadre de vie), mais également des autres forces de sécurité disponibles et éventuellement de spécialistes tels que des acousticiens et inspecteurs de salubrité publique. Lorsqu’ils constatent le trouble anormal de voisinage, ils sont en mesure de prendre des mesures immédiates de rappel à l’ordre et en dernier lieu de saisir le Procureur de la République.
L’ultime recours reste celui porté devant les juridictions civiles (saisie du tribunal d’instance ou de grande instance, si le préjudice estimé est supérieur à 10 000€), ou pénales (dépôt de plainte) afin de faire valoir ses droits devant un juge, et obtenir une indemnisation ainsi qu’une sanction financière pour le responsable.
Enfin, rappelons que le propriétaire bailleur est responsable de son locataire, qui n’est pas exonéré des obligations de jouissance paisible sur le motif qu’il n’est pas propriétaire. Ainsi, depuis la loi 2007-297 du 5 mars 2007, le propriétaire est en droit de résilier le bail à tout moment en cas de troubles de voisinage établis. Lorsqu’il n’intervient pas auprès de son locataire pour faire cesser le trouble, il peut même engager sa responsabilité à l’égard du tiers lésé.
![]()
